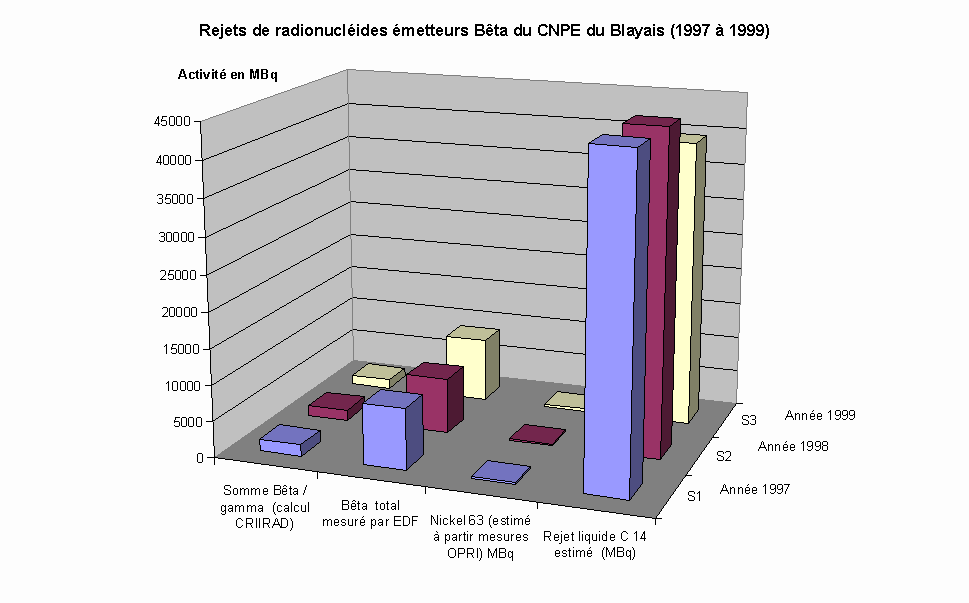
| Expertise Criirad |
Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD)Etude critique de l’évaluation de l’impact radioécologique du CNPE du Blayais
Synthèse / octobre 2002
Étude réalisée par le laboratoire de la CRIIRAD
Préambule.
La CRIIRAD n’a effectué dans le cadre de cette étude aucune mesure de radioactivité. Son travail a consisté à étudier la documentation officielle mise à disposition par EDF, afin d’identifier d’éventuelles lacunes et de proposer à la CLI des recommandations visant à améliorer les connaissances et l’information du public dans le domaine de l’impact radiologique de la centrale.
Notions préliminaires.
Même en fonctionnement normal, une centrale électronucléaire rejette des éléments radioactifs dans l’atmosphère et dans les fleuves. Elle dispose d’autorisations de rejet fixant les limites annuelles à ne pas dépasser.
Origine des éléments radioactifs
Les réactions nucléaires qui ont lieu au sein du combustible constitué d’uranium et de plutonium donnent naissance au sein des crayons à des radionucléides artificiels appelés produits de fission. Ceux qui sont sous forme gazeuse comme certains gaz rares (isotopes du krypton et du xénon) ou les isotopes de l’iode (iode 131) diffusent à travers les gaines des crayons et se retrouvent dans l’eau du circuit primaire. D’autres produits de fission métalliques relativement solubles (par exemple, le césium 137) parviennent également à traverser la gaine. En cas de rupture de gaine ou de porosité anormale des gaines, l’uranium et le plutonium contenus dans le combustible pourraient également se retrouver dans le circuit primaire.
Les neutrons produits lors de la fission de l’uranium sont très pénétrants. Ils interagissent avec tous les matériaux présents dans la cuve du réacteur et ces collisions (activation neutronique) engendrent des substances radioactives appelées produits d’activation. Ainsi une partie des atomes non radioactifs de bore et lithium (ajoutés à l’eau), d’oxygène et azote (dissous dans l’eau), de nickel et de cobalt (contenu dans les aciers), d’argent (recouvrant les grappes de commande), se transforment en éléments radioactifs, respectivement : tritium (hydrogène radioactif), carbone 14, cobalt 58, nickel 63, cobalt 60, argent 110m (liste non exhaustive).
Les rejets radioactifs
Tous ces éléments radioactifs artificiels qui contaminent l’eau du circuit primaire se retrouveront dans les effluents liquides et gazeux de la centrale. En effet, le fonctionnement de l’installation impose d’effectuer des mouvements d’eau (par exemple pour agir sur le taux de bore dissous qui permet de contrôler la réaction nucléaire), des purges de circuits, la collecte de fuites, etc…Par ailleurs, lors du rechargement en combustible neuf, la cuve est ouverte. Les effluents gazeux et liquides sont traités avant rejet (par exemple, filtres pour retenir les poussières radioactives, résines échangeuses d’ions pour les liquides). Mais même si des progrès significatifs ont été effectués par EDF depuis 10 ans afin de limiter les rejets radioactifs, certains éléments sont difficiles à piéger avant rejet, il s’agit en particulier des gaz rares, du tritium et du carbone 14.
Objectifs de l’étude.
L’étude qui s’est déroulée de juin 2001 à octobre 2002, avait pour objet de rechercher les éléments de réponse à 4 questions :
1 / Insuffisances de la caractérisation radiochimique des effluents avant rejet et des études de conception
Les éléments radioactifs présents dans l’air et les liquides avant rejet sont contrôlés par EDF selon des protocoles imposés par les autorités (ex-OPRI). Ces procédures ne sont pas suffisamment pointues pour permettre d’identifier et de quantifier tous les radionucléides présents. Ceci est particulièrement vrai pour les radionucléides qui n’émettent en se désintégrant que des rayonnements bêta. En effet, pour certains comme le tritium, le carbone 14 ou le nickel 63 l’énergie des rayonnements bêta émis est trop faible pour être correctement enregistrée par les appareils de contrôle. Dans ces cas là, il faut mettre en œuvre des moyens de mesure plus perfectionnés et spécifiques à chaque radionucléide.
C’est ainsi qu’EDF mesure à part le tritium présent dans les effluents.
Mais le nickel 63 n’est mesuré que depuis 1994 par l’OPRI sur un échantillon représentatif des effluents liquides rejetés dans le mois. Il était important de le mesurer puisqu’il est, selon les années, en 5ème ou 6eme position en terme d’activité rejetée en Gironde et qu’il présente une période physique relativement longue (100 ans).
Le carbone 14 n’est pas mesuré du tout. A partir des estimations théoriques sur son taux de production au sein de la centrale on peut estimer qu’il est pourtant en seconde position dans les rejets liquides (après le tritium) et en 3ème position dans les rejets gazeux (après les gaz rares et le tritium). Il est surprenant qu’il ne soit pas mesuré compte tenu de sa longue période physique (5 730 ans) et de sa disponibilité biologique (une fois rejeté dans l’environnement il va intégrer le cycle du carbone et se retrouver au cœur de nos cellules dont la matière est constituée entre autres d’atomes d’hydrogène et de carbone).
La CRIIRAD estime que le système de mesure de la radioactivité des émetteurs bêta avant rejets pourrait sous-estimer d’un facteur 5 les activités réellement rejetées (cf graphe ci-dessous). Les incertitudes sur les activités réellement rejetées pour le carbone 14 et le nickel 63 pourraient masquer par ailleurs la présence d’autres radionucléides émetteurs bêta purs.
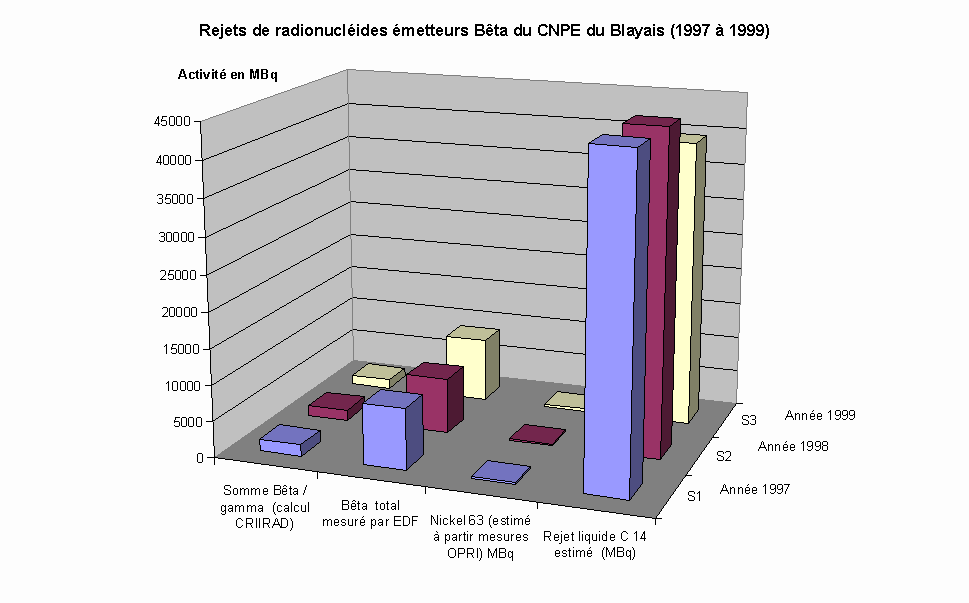
La CRIIRAD a tenté de reconstituer une liste de tous les radionucléides susceptibles de se trouver dans le cœur du réacteur du fait des réactions de fission et d’activation. Mais EDF ne semble pas disposer de toutes les informations nécessaires à la réalisation d’un inventaire exhaustif. Les centrales nucléaires sont donc exploitées depuis plusieurs décennies alors que la liste des radionucléides qu’elles rejettent dans l’environnement n’est pas établie avec précision. En effet, les spécialistes d’EDF s’attachent en priorité à prévoir la nature et l’activité des produits radioactifs à vie longue créés au sein des assemblages irradiés de manière à anticiper les conditions de leur entreposage par l’ANDRA. Mais ces études ne semblent pas prendre suffisamment en compte l’inventaire radiologique du cœur par rapport aux rejets dans l’environnement durant le fonctionnement du réacteur.
Recommandations
Il est donc possible que des radionucléides, produits de fission ou d’activation, soient rejetés par la centrale du Blayais ou d’autres centrales REP sans que les rejets ne soient comptabilisés ni déclarés correctement.
C’était le cas pour le nickel 63, qui n’est mesuré que depuis 1994 dans les rejets liquides du CNPE du Blayais et c’est toujours le cas du carbone 14, qui n’apparaît pas dans les déclarations de rejet (gaz et liquide) du Blayais. Le dosage spécifique du carbone 14 sera probablement imposé au CNPE du Blayais dans le cadre du renouvellement des autorisations de rejet, mais il n’est pas possible de garantir que d’autres émetteurs bêta purs ne méritent pas une égale attention.
La CRIIRAD recommande donc à la CLI qu’elle entame des démarches visant à obtenir :
2 / Les rejets radioactifs du CNPE du Blayais
Notions préliminaires
L’effet des rayonnements ionisants sur les êtres humains est déterminé à partir d’une évaluation des doses efficaces (en microSieverts : µSv). Officiellement en France, l’exposition moyenne de la population à la radioactivité naturelle est estimée à 2 400 µSv par an.
Les experts de la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) considèrent que toute dose de radiation augmente les risques de cancers et d’anomalies génétiques.
S’agissant de la radioactivité naturelle, la CIPR recommande donc depuis 1993 de limiter en particulier l’exposition au radon dans l’habitat. En effet, le nombre de morts par cancer du poumon imputables au radon pourrait s’élever à plusieurs milliers de cas chaque année.
S’agissant de l’exposition due aux activités humaines (non naturelle), la CIPR a édicté 3 principes en matière de protection sanitaire des populations contre les dangers liés aux rayonnements ionisants. La justification, l’optimisation et la détermination d’une limite annuelle de dose au-delà de laquelle les risques cancérigènes sont jugés inacceptables. La limite de dose (ajoutée par les activités humaines) au delà de laquelle les risques de cancer mortel étaient jugés inacceptables était de 15 000 µSv par an en 1952, elle est désormais de 1 000 µSv par an compte tenu de l’évolution des connaissances sur la dangerosité des rayonnements ionisants (cela correspond à un risque de 50 cancers mortels pour 1 million de personnes exposées). La directive Euratom de mai 1996 considère par ailleurs que toute pratique qui expose les individus du public à une dose supérieure à 10 microSieverts par an a un impact non négligeable sur le plan sanitaire.
Le principe d’optimisation impose à EDF de faire tout ce qui est économiquement et socialement raisonnable pour limiter l’impact radiologique de ses centrales et donc, entre autres, ses rejets radioactifs.
Des autorisations de rejet disproportionnées
L’arrêté interministériel du 9 mars 1981 fixe les autorisations de rejet du CNPE du Blayais pour 4 catégories de radionucléides.
A ce jour, la CRIIRAD n’a jamais pu obtenir des pouvoirs publics de document justifiant les modalités de fixation des premières autorisations de rejet accordées aux centrales nucléaires, alors que souvent les valeurs retenues étaient très supérieures aux besoins des exploitants.
Ainsi, les rejets déclarés par le CNPE du Blayais pour l’année 2000 représentaient 32 % des autorisations pour le tritium liquide mais étaient inférieurs à 1 % des autorisations pour les 3 autres catégories (gaz, halogènes gazeux et aérosols, liquides hors tritium). Sur l’ensemble de la période 1994 / 2000 les rejets pour ces 3 catégories sont restés inférieurs à 3 % des autorisations de rejet.
Un tel décalage entre le niveau des autorisations réglementaires et les possibilités techniques de l’exploitant n’est pas très satisfaisant sur le plan de la radioprotection. En effet, il ne constitue pas une incitation forte à la réduction des rejets. De plus les gammes de radionucléides prises en compte pour fixer les autorisations sont trop floues et peuvent conduire à gommer des évolutions importantes pour certains radionucléides particuliers. La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) considérait d’ailleurs que le maintien de limites trop élevées par rapport aux possibilités techniques " n’est pas justifiable ".
Pourtant dans le cadre du dossier soumis à enquête publique du 28 janvier au 8 mars 2002, le CNPE du Blayais maintient des demandes d’autorisation de rejet disproportionnées pour certains radionucléides. Ainsi les rejets réels de tritium à l’atmosphère représentaient en 1999 moins de 6 % des autorisations demandées, les rejets d’iode par voie liquide moins de 5 %.
Dans le même temps, le CNPE du Blayais dispose d’un contrat de gestion élaboré en concertation avec l’échelon national, qui prévoit des rejets radioactifs liquides (hors tritium) 400 fois inférieurs aux autorisations de rejet de 1981 et 16 fois inférieurs aux nouvelles demandes d’autorisation.
Evolution des rejets radioactifs liquides du CNPE du Blayais depuis 1994
Comme le montre le
graphique G1 ci-dessous, des progrès très significatifs ont été réalisés par le CNPE du Blayais en matière par exemple de limitation des rejets de radionucléides émetteurs gamma en Gironde. (rejets d’argent 110m, cobalt 60, cobalt 58, césium 137 divisés par 2 à 6 entre 1994 et 2000).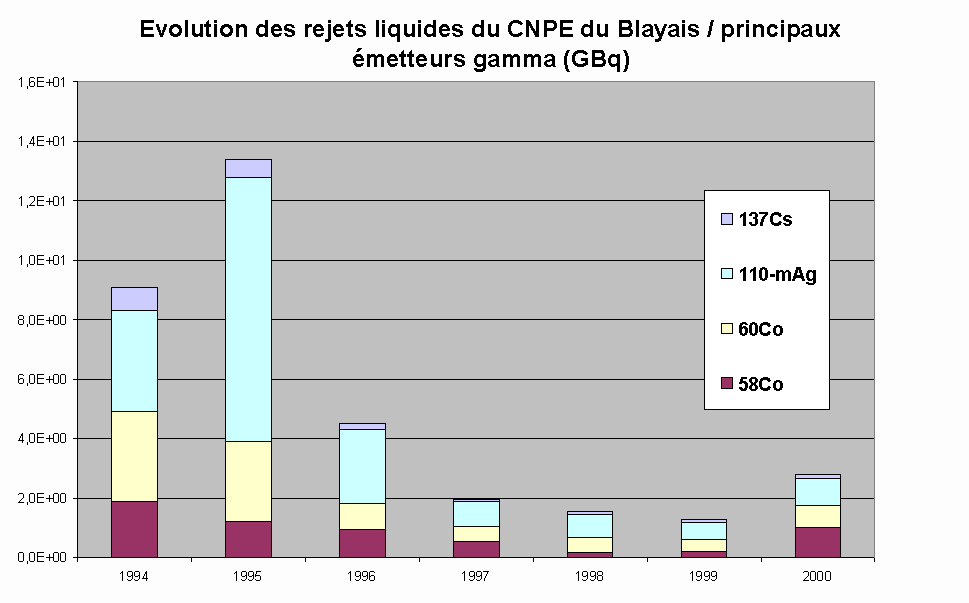
Mais les rejets de radionucléides émetteurs gamma ne représentent qu’une très faible fraction des rejets : (3,2 GBq selon EDF en 2000) par rapport aux 2 radionucléides principaux rejetés par voie liquide :
On observe par ailleurs que les rejets de tritium restent stables sur la période considérée (cf ci-dessous graphique concernant le tritium).
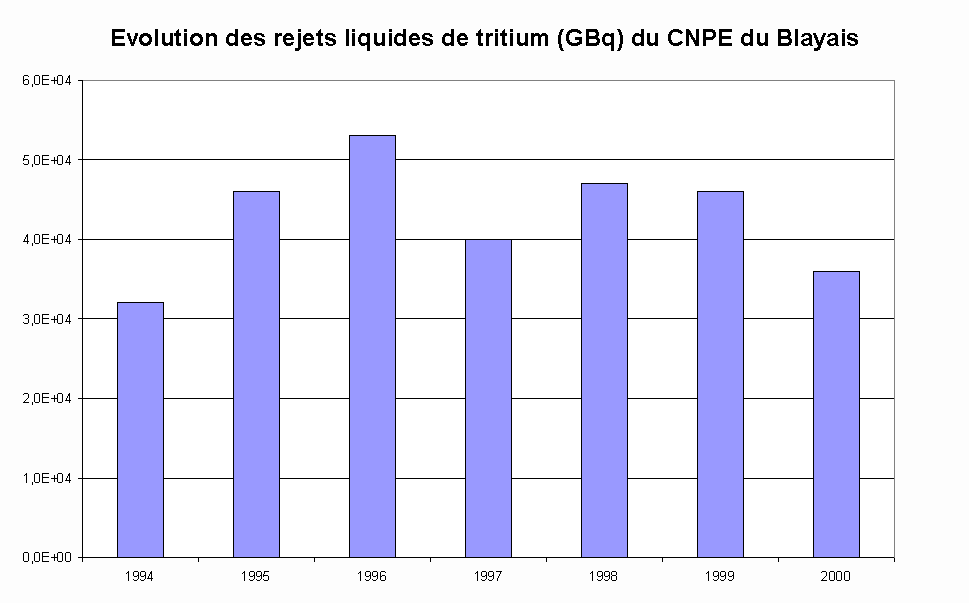
Evolution des rejets radioactifs atmosphériques du CNPE du Blayais depuis 1994
Concernant les principaux radionucléides rejetés dans l’atmosphère (gaz rares, tritium et carbone 14), les résultats sont difficilement interprétables dans la mesure où :
On peut noter que les rejets de tritium sont maintenus au même niveau depuis 1994 (cf
graphe ci-dessous).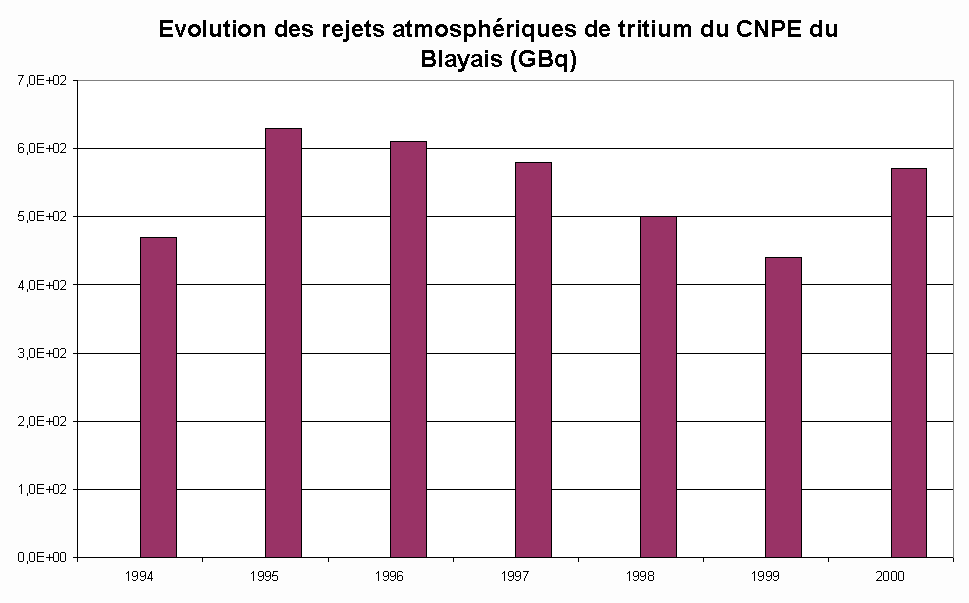
Comparaison avec d’autres centrales électronucléaires
EDF n’a pas été en mesure de fournir une étude comparative des rejets du CNPE du Blayais par rapport à d’autres centrales de même type à l’étranger. La comparaison effectuée avec les autres centrales REP 900 MW exploitées en France montre que le CNPE du Blayais n’effectue pas les rejets les plus faibles du parc :
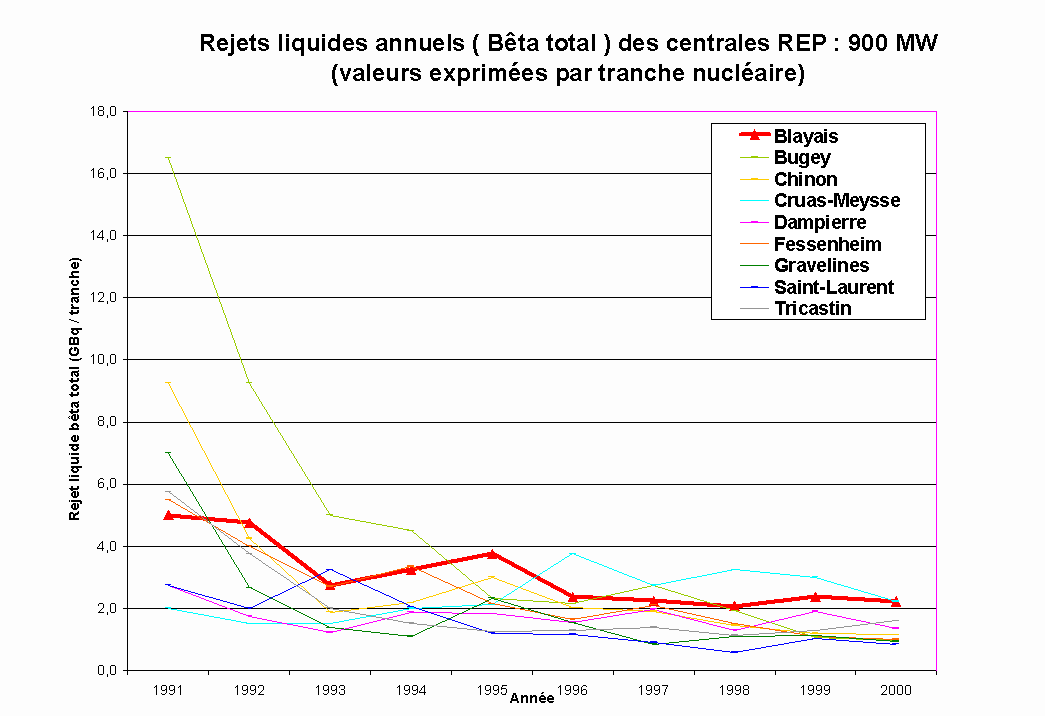
Recommandations concernant les rejets
Le principe d’optimisation en radioprotection impose que tout ce qui est raisonnablement possible soit fait pour limiter l’exposition des populations. Ceci passe en particulier par une réduction des rejets radioactifs.
De ce point de vue, il est indispensable que les autorisations de rejets soient réellement contraignantes pour l’exploitant, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui.
La révision prochaine des autorisations de rejet du CNPE devrait être l’occasion d’une telle amélioration réglementaire. La CRIIRAD recommande que les populations riveraines du CNPE du BLAYAIS et leurs représentants veillent à travers la CLI à ce que les futures autorisations de rejet du CNPE :
Le CNPE du Blayais, comme d’autres sites du parc a réalisé des efforts conséquents depuis plus de 10 ans en matière de réduction des rejets (en particulier pour les liquides hors tritium). Il n’a cependant pas été en mesure de quantifier les marges de progrès pour le futur. Il n’est donc pas possible pour un observateur extérieur de déterminer dans quelle mesure le principe d’optimisation est strictement appliqué (comparaison entre le coût des améliorations et la baisse consécutive des rejets radioactifs).
Dans un souci de transparence et afin qu’elle puisse disposer de critères d’analyse suffisants, la CRIIRAD recommande que la CLI demande au CNPE du BLAYAIS un certain nombre de données complémentaires :
3 / Evaluation des doses subies par les riverains du CNPE du Bayais
3.1 Doses liées aux rejets radioactifs
Les calculs effectués par EDF pour évaluer l’exposition chronique annuelle de la population soumise aux rejets radioactifs du CNPE du Blayais aboutissent à des résultats très faibles (moins de 0,3 µSv/an pour les rejets mesurés en 1999).
La CRIIRAD considère que ces résultats sont très discutables et que la modélisation utilisée par EDF mérite d’être affinée car elle comporte de nombreuses lacunes :
3.2 Doses liées à la sortie de matières contaminées via la circulation des personnes et des matériels
Des matériels contaminés ou des personnes ayant des vêtements contaminés ont été détectés dans le passé en sortie de zone contrôlée voire en sortie de site. En 2000, 46 cas de contamination vestimentaire " comprise entre 800 et 10 000 Bq " ont été détectés.
Compte tenu des seuils de détection des portiques (50 000 Bq depuis janvier 1999, pour les portiques contrôlant le matériel et 3 000 Bq depuis avril 2000, pour les portiques C3 contrôlant les piétons), il est réaliste de considérer que, si les niveaux de contamination sont inférieurs à ces seuils de détection, les matériels ou les personnes affectées de ces contaminations quittent effectivement le site.
Pour des radionucléides émetteurs gamma moins irradiants que le cobalt 60 et pour des cocktails de radionucléides comprenant des émetteurs bêta purs, les activités susceptibles de ne pas être détectées seraient d’ailleurs supérieures aux valeurs données par EDF (valeurs correspondant à une contamination par le cobalt 60).
Selon le caractère fixé ou non fixé de cette contamination, et selon la nature des radionucléides en question, les doses subies par le public peuvent ne pas être négligeables (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de microSieverts), voire inacceptables au sens de la réglementation en vigueur (plus de 1 000 microSieverts).
Bien qu’il s’agisse d’expositions individuelles à faible probabilité d’occurrence, la CRIIRAD considère qu’il serait utile de comparer ces chiffres à celui de moins de 0,3 microsieverts, qui correspond, selon EDF, à l’exposition chronique du groupe de population le plus exposé aux rejets autorisés d’une année de fonctionnement du CNPE.
Depuis 1998 des efforts importants ont été effectués dans le domaine de ce qu’EDF appelle la " propreté radiologique ". Ces efforts sont essentiels car de nombreux dysfonctionnements ont existé dans le passé. Du fait de la mise en place de portiques de détection plus sensibles, les risques de sortie de matières ou vêtements contaminés sont donc en voie de diminution.
Compte tenu cependant du caractère non négligeable des doses potentielles liées à la sortie de matières ou vêtements contaminés, la CRIIRAD considère que les efforts d’EDF doivent être maintenus et approfondis, et qu’il serait utile :
La vigilance sur ce plan doit être permanente. A titre indicatif, on peut rappeler que l’OPRI signale pour la période octobre / novembre 2001, la détection de points de contamination ou débits de dose non conformes, hors zone contrôlée, sur les sites EDF de Chinon, Saint-Laurent des Eaux et le Blayais.
3.3 Doses liées au transport de matières radioactives
Notions préliminaires
Lors du transport de déchets irradiants ou de combustibles usés, un certain champ de radiation gamma et neutron est mesurable autour du colis et du véhicule même si aucune contamination surfacique n’est présente (la CRIIRAD a pu détecter, en 1998, près de Lyon, l’augmentation du flux gamma ambiant lié à l’approche d’un wagon de combustible usé à 40 mètres de distance, cf photo ci-dessous).

En effet, la désintégration de certains radionucléides, ou certaines des réactions qui ont lieu au sein des substances radioactives transportées, conduisent à l’émission de rayonnements gamma et de neutrons qui traversent en partie les blindages.
Le Règlement International pour le Transport des Matières Dangereuses par le chemin de fer, complété par l’arrêté du 6 décembre 1996 dit arrêté RID fixe des limites de débit de dose très élevées (jusqu’à 2 000 microSieverts par heure au contact de la surface du wagon ou du véhicule et 100 microSieverts par heure à 2 mètres de celui-ci). Pour le transport par route, l’arrêté ADR fixe des limites comparables
Il suffit de stationner 6 minutes à 2 mètres de ce type de véhicule pour dépasser le seuil du risque négligeable, 3 heures pour dépasser la contrainte de 300 microSieverts par an et 10 heures pour dépasser la dose maximale annuelle admissible.
Etant donné que ces matériaux transitent par le domaine public (sur route ou voie ferrée), la CRIIRAD attire l’attention de la CLI sur le fait que les limites de dose des règlements pour le transport des matières radioactives sont trop élevées par rapport aux limites fondamentales de dose pour le public ou certains groupes de travailleurs non DATR.
La CRIIRAD tient à signaler ici qu’elle a eu l’occasion à plusieurs reprises de suivre des véhicules de transport de matières radioactives et d’en mesurer le champ de radiation, sur des routes du réseau secondaire (à la Hague) ou sur autoroute (ASF). La CRIIRAD rappelle qu’il est important de veiller à ce que les automobilistes ne se trouvent pas trop près de ces véhicules (embouteillage ?, parking ?), et qu’elle a entrepris depuis plusieurs années des démarches auprès de la Commission Européenne pour faire réviser ces normes.
Compte tenu de ces éléments, la CRIIRAD recommande que la CLI demande à EDF d’apporter la preuve que tout est fait pour éviter que des personnes du public stationnent à proximité de ce type de véhicule ou de wagon. Dans ce cadre, EDF devrait également procéder à une estimation de l’exposition externe susceptible d’être subie par le public du fait des transports de matières irradiantes.
A / Transport de combustibles usés
Au cours de l’année 2000, le CNPE du Blayais a expédié 16 convois de combustible usé.
Les combustibles usés en château de transport sont expédiés sur remorque vers la gare de Saint-Yzan située à environ 30 km du CNPE du Blayais. Ils sont alors chargés sur wagon (selon EDF, la manutention dure 3 heures maximum), sur une aire spécifique louée à la SNCF, dans une " zone qui n’est pas accessible au public ".
Selon EDF, le camion ne part du CNPE du Blayais que " si la SNCF a donné le feu vert par fax. Il appartient à la gendarmerie de fixer l’itinéraire ".
La CRIIRAD a demandé communication du détail des mesures de débit de dose gamma et neutron réalisées sur les chateaux de combustible usé expédiés en 2000 Il n’existe pas en effet de tableau de synthèse tenu à jour pour toutes les années.
Les résultats des mesures de débits de dose (gamma et neutrons) effectuées par EDF varient dans la gamme suivante :
Une personne stationnant à 2 mètres du véhicule ou du wagon le plus irradiant pendant seulement 30 minutes recevrait donc une dose de 45 microsieverts, soit plus de 4 fois supérieure au seuil du risque négligeable et plus de 150 fois supérieure à la dose annuelle calculée par EDF pour l’impact dû aux rejets réels de 1999.
La CRIIRAD, qui a eu l’occasion de mesurer sur le quai voyageur de la gare de Valognes (Manche) des débits de dose de 30 µSv/h (hors neutron) alors qu’un wagon de combustible usé était en stationnement, tient à souligner que ce type de situation n’est pas irréaliste.
B / Transport de déchets radioactifs
En 2000, le CNPE du Blayais indique avoir expédié 37 colis de déchets radioactifs par route (40 à 50 habituellement).
Un tableau de synthèse concernant les résultats des contrôles du niveau de rayonnement au contact des colis de déchets radioactifs n’a pu être élaboré par EDF compte tenu du nombre de colis traités.
A défaut EDF, a fourni à la CRIIRAD un " exemple de débit de dose de convoi de déchets ". Les débits de dose mesurés au contact sont de l’ordre de 80 à 120 µSv/h (soit 800 à 1 200 fois supérieurs à la normale) et 20 à 30 µSv/h à 2 mètres (soit 200 à 300 fois supérieurs à la normale). Mais EDF ne précise pas s’il s’agit de valeurs représentatives ou d’exemples pris au hasard.
Il serait utile de disposer d’une évaluation des situations (occurrence, durée et distance) où des personnes peuvent stationner à proximité d’un wagon ou d’un camion transportant des déchets radioactifs ou combustibles irradiés. Les débits de dose mesurés par EDF à 2 mètres des colis de déchet ou des châteaux de transport sont en effet de l’ordre de 20 à 90 µSv/h.
Dans un souci de transparence, la CRIIRAD recommande à la CLI d’obtenir d’EDF les résultats des mesures de débit de dose réalisées à proximité des convois de transport de matières irradiantes, complétés par une synthèse annuelle et l’évaluation de l’exposition résultante pour le public.
La CRIIRAD considère également que les procédures de transport doivent être revues soit par un abaissement des débits de dose autorisés soit par un encadrement strict des transports interdisant toute approche de personnes du public ou de travailleurs non DATR. Ces doses pourraient être en effet de plusieurs dizaines, voire centaines, de microSieverts si des précautions spécifiques ne sont pas prises (panneaux précisant par exemple qu’il ne faut pas approcher, etc ..).
3.4 Synthèse concernant l’évaluation des doses
Lacunes dans l’évaluation des doses
La fiabilité des modèles de calcul de l’exposition des populations aux rejets chroniques n’est pas garantie par des confrontations modèles / mesures. De plus, le terme source est incomplet, et certaines voies d’exposition ne sont pas prises en compte. Ces modèles doivent être revus, en particulier en ce qui concerne le carbone 14, le tritium, le nickel 63 et les gaz rares.
Les situations d’exposition incidentelles individuelles liées à la sortie de matériels et vêtements contaminés, ou à l’irradiation externe lors du transport de matières irradiantes ne sont pas comptabilisées. Il est pourtant démontré qu’elles pourraient représenter, pour certains individus, des doses annuelles de plusieurs dizaines, voire centaines de microsieverts. Des scénarios réalistes d’exposition, basés sur les chiffres détaillés dont seul dispose EDF devraient être présentés.
Aucune évaluation de la dose collective liée aux rejets du CNPE n’est effectuée, alors que certains des radionucléides prépondérants dans les rejets ont une longue (tritium : 12 ans), voire très longue période (carbone 14 : 5 730 ans). Ils présentent par ailleurs un fort pouvoir de diffusion dans l’environnement et font partie des éléments de base de la matière vivante.
Information du public
La CRIIRAD attire l’attention de la CLI sur l’intérêt de demander à EDF de rendre publiques les données concernant la contamination des voiries, des transports ou des vêtements des travailleurs, en intégrant dans les tableaux les valeurs maximales des contaminations détectées, qu’elles soient ou non supérieures aux différents seuils de déclaration.
De même, les rejets de carbone 14 et de nickel 63 devraient être publiés.
Comparaison avec les limites de doses
Dès 1985, la CIPR recommandait d’abaisser la limite de dose maximale annuelle admissible de 5 000 à 1 000 µSv/an (déclaration de Paris). Cette nouvelle limite fut intégrée en 1990 dans les textes de la CIPR (CIPR 60). La directive Euratom de mai 1996 a abaissé cette limite à 1 000 µSv/an et elle a été intégrée récemment dans la réglementation française (Code de la Santé Publique et Décret du 4 avril 2002).
Malgré ces évolutions dans les connaissances sur la dangerosité des rayonnements ionisants, EDF comparait encore ces dernières années les expositions ajoutées par ses activités à la limite de dose de 5 000 µSv/an.
Dans le dossier DARPE du CNPE du Blayais récemment soumis à enquête publique, EDF se réfère bien à la nouvelle limite de 1 000 µSv/an (il serait utile de vérifier si c’est le cas également dans le résumé non technique à destination du public). Ce faisant, EDF oublie de préciser que cette valeur constitue la limite annuelle réglementaire
de l’exposition totale à l’ensemble des sources de rayonnement artificiel (exposition hors rayonnement naturel et médical). Rappelons que cette limite, qui marque la limite du risque tolérable, correspond en effet à un risque cancérigène de 5x10-2 par sievert (ce qui signifie que, dans un groupe de 100 000 personnes exposées à une dose de 1 000 µSv, on s’attend à enregistrer 5 décès par cancer radio-induit).Dans la mesure où plusieurs termes sources peuvent coexister, c’est à la somme de toutes ces contributions que doit être comparée la limite. Dans la région de Bordeaux, la population peut en effet être soumise, par exemple, aux rejets liquides de la centrale de Golfech, à l’impact des activités du CESTA (expérimentations à l’uranium appauvri), à l’impact des anciennes activités de l’usine de production d’acide phosphorique Grande Paroisse à Bordeaux (arrêtée en 1983), aux rejets des services de médecine nucléaire, aux impacts des installations de recherche, etc…
L’exposition induite par la seule centrale du Blayais doit donc être comparée à une contrainte de dose.
En Suisse, les valeurs admissibles de rejets, pour les centrales nucléaires, ont été fixées de manière à ce que la dose d’irradiation du groupe critique de la population reste inférieure à 200 µSv/an. Au niveau international, la contrainte de dose prenant en compte l’impact d’une seule installation est de 300 µSv/an.
La CRIIRAD tient à souligner ici que la CIPR insiste sur le fait que le risque persiste en dessous de la limite. Il est cependant jugé tolérable à condition que les deux autres principes fondamentaux de justification et d’optimisation soient respectés.
Des progrès ont été accomplis par EDF depuis quelques années en terme de limitation de certaines expositions : installation de portiques de détection plus sensibles en sortie de site, réduction des situations de contamination surfacique des transports, baisse des rejets liquides pour la plupart des radionucléides, etc.
La CRIIRAD considère qu’il est important que ces efforts soient poursuivis dans le respect du principe d’optimisation des expositions. Les expositions peuvent probablement être encore raisonnablement réduites dans plusieurs domaines (limitation des rejets, information sur l’irradiation externe des transports à destination du public, audit des situations de sortie de site de matériels ou vêtements contaminés).
La CRIIRAD estime qu’il serait utile qu’EDF présente chaque année à la CLI un bilan des évolutions dans ce domaine.

4 / Insuffisance des contrôles portant sur l’environnement.
Ayant analysé les programmes de contrôle radiologique mensuels, annuels, et effectués dans le cadre du bilan décennal, par EDF ou par l’IPSN (pour EDF), la CRIIRAD considère que ce dispositif n’est pas en mesure de permettre une évaluation satisfaisante du marquage de l’environnement et de l’exposition ajoutée, ni une validation a posteriori du modèle utilisé par EDF pour calculer l’exposition chronique de la population aux rejets radioactifs du CNPE du Blayais.
4.1 Exposition externe
Le système de contrôle de l’exposition externe (rayonnement gamma uniquement) au voisinage du CNPE du Blayais a été nettement amélioré ces dernières années. Alors qu’il ne comportait que 4 capteurs situés dans un rayon de 1 km, il a été complété par 10 capteurs situés à la clôture, 4 capteurs dans un rayon de 5 km et 10 capteurs dans un rayon de 10 km.
L’examen des mesures des capteurs du réseau clôture montre des variations temporelles élevées (facteur 4 à 101 pour les 3 capteurs situés à la clôture côté Gironde, cf graphe ci-après). Ces augmentations du niveau de radiation sont probablement liées aux activités du CNPE (stockage et déplacement de matières irradiantes par exemple).
L’exposition ajoutée pour une personne passant 100 % de son temps à la clôture pourrait être comprise entre le non mesurable et 476 à 650 µSv/an selon le choix du niveau de référence de l’irradiation naturelle dans le secteur.
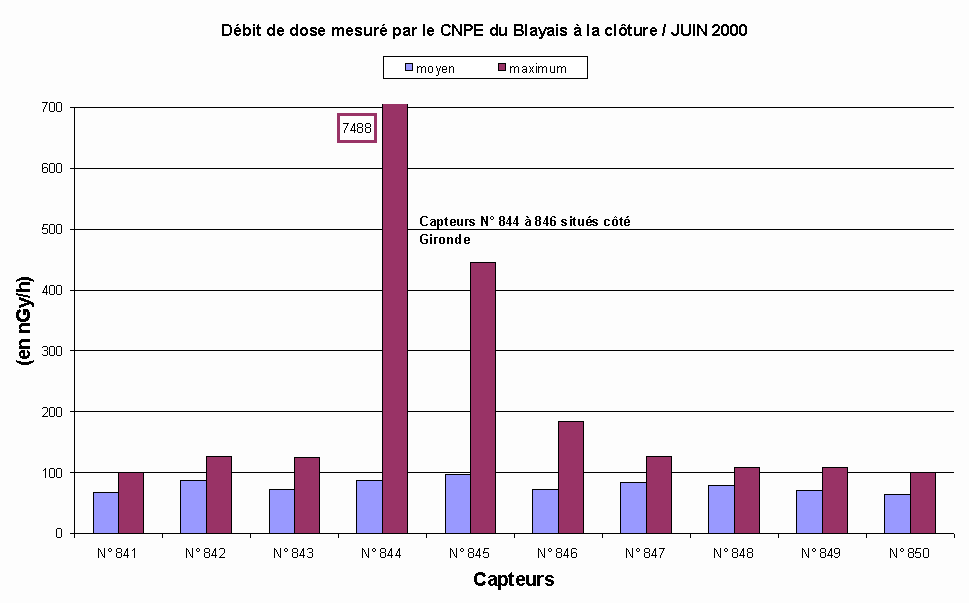
La CRIIRAD recommande à la CLI qu’elle demande à EDF un certain nombre d’améliorations dans le domaine du contrôle de l’exposition externe :
4.2 Contrôle de l’air et des eaux de pluie
Le CNPE dispose de 4 appareils de prélèvements des poussières atmosphériques. On peut s’étonner de l’absence de capteur à l’ouest de la centrale alors que les roses des vents montrent que ce secteur est sous influence. De plus, les contrôles effectués ne portent que sur la radioactivité des poussières. Or plus de 99,999 % des radionucléides sont sous forme de gaz et ne peuvent être retenus donc détectés par les capteurs mis en place.

La CRIIRAD recommande à la CLI qu’elle demande à EDF un certain nombre d’améliorations dans le domaine du contrôle de la radioactivité de l’air et des eaux de pluie :
4.3 Contrôle du milieu terrestre et du milieu aquatique de surface
Les mesures effectuées par EDF
Le CNPE du Blayais effectue des contrôles réglementaires mensuels de l’activité bêta totale d’échantillons d’herbe et de lait. Ces contrôles sont inadaptés pour détecter une éventuelle contamination en tritium et carbone 14 qui sont pourtant les principaux radionucléides rejetés dans l’atmosphère après les gaz rares. La Direction des Installations Nucléaires de Bordeaux reconnaît que ces mesures ont " pour objet de constituer un point zéro actualisé en cas de rejet accidentel ". Elles sont donc insuffisantes pour apprécier l’impact des rejets chroniques.
Le CNPE du Blayais effectue des contrôles réglementaires réguliers de la radioactivité des eaux de la Gironde. Ces contrôles ne permettent pas de déceler l’impact réel des rejets radioactifs liquides car les mesures réalisées ne sont pas suffisamment sensibles (seuil de détection trop élevé pour le tritium, pas de mesure spécifique de l’activité du carbone 14, pas de spectrométrie gamma). De plus, il ne semble pas que les situations où l’activité bêta totale n’est pas expliquée par la radioactivité naturelle (potassium 40) fassent l’objet d’analyses approfondies. La CRIIRAD recommande que le protocole de contrôle soit amélioré.
Les campagnes annuelles de l’IPSN
Des programmes de contrôle annuels sont réalisés pour EDF par l’IPSN (spectrométrie gamma).
S’agissant du milieu terrestre, l’IPSN précise : " De 1992 à 1999 seul le césium 137 est détecté dans les sols, une mousse, la salade, le vin, et le lait. Aucun autre émetteur gamma présent dans les rejets gazeux des REP n’est décelé. Le césium 137 provient donc majoritairement des retombées atmosphériques des anciens tirs nucléaires aériens et de celles de l’accident de Tchernobyl ".
Pour l’environnement aquatique, les travaux de l’IPSN montrent que les radionucléides artificiels émetteurs gamma rejetés par le CNPE du Blayais ne sont plus détectés depuis 1998 (à l’exception du césium 137). Ceci est cohérent compte tenu de la diminution des rejets radioactifs du CNPE pour ces radionucléides.
Néanmoins les principaux radionucléides rejetés par voie atmosphérique et par voie liquide n’étant pas détectables par spectrométrie gamma (tritium, carbone 14, nickel 63 pour la voie liquide) le protocole d’étude mis en place par l’IPSN est insuffisant.
Bilan décennal 1993
Le bilan décennal réalisé par l’IPSN en 1993 ne comportait aucune mesure de carbone 14, une vingtaine de mesures de tritium pour le milieu terrestre et 9 pour le milieu aquatique, mais du fait des insuffisances du programme d’échantillonnage et de mesure ces résultats ne sont pas interprétables.
La détection par l’IPSN d’une forte activité bêta totale dans les sédiments de Vitrezay à 8 km en aval du CNPE ne semble avoir donné lieu à aucune recherche complémentaire.
La CRIIRAD recommande à la CLI qu’elle demande à EDF un certain nombre d’améliorations dans le domaine du contrôle de la radioactivité du milieu terrestre et du milieu aquatique de surface :
4.4 Contrôle du milieu aquatique souterrain
Le CNPE du Blayais effectue un contrôle mensuel des eaux souterraines en 5 stations réparties sur l’ensemble du site à une profondeur comprise entre 10 et 15 mètres. Les activités bêta globales sont mesurées ainsi que le tritium.
Le tritium étant extrêmement mobile, il peut permettre de déceler une fuite mettant en cause d’autres radionucléides qui mettront plus de temps à se disperser dans l’environnement. En détectant au plus tôt une teneur anormale en tritium, il est possible de limiter l’impact d’autres pollutions.
Les limites de détection obtenues par EDF pour le dosage du tritium (< 30 à 40 Bq/l) sont insuffisantes pour permettre de dépister rapidement une pollution par du tritium d’origine artificielle.
Les mesures de tritium réalisées par le CNPE du Blayais de mai 1981 à octobre 1982 dans les 5 piézomètres, étaient pourtant réalisées avec une limite de détection de l’ordre de 11 à 12 Bq/l. Curieusement, depuis novembre 1982, la limite a été augmentée (< 40 à 50 Bq/l). Ceci est d’autant plus étonnant qu’en janvier 1982 des valeurs significatives de tritium étaient mesurées en N3 (15 Bq/l) et N4 (14 Bq/l). Ces valeurs étaient nettement supérieures à celles obtenues lors du point zéro de 1978 dans des forages situés dans l’enceinte ou en bordure du CNPE (0,96 à 2,3 Bq/l).
La CRIIRAD recommande à la CLI qu’elle demande à EDF un certain nombre d’améliorations dans le domaine du contrôle de la radioactivité des eaux souterraines :
Compte tenu des lacunes identifiées dans les plans de contrôle d’EDF et de l’IPSN, la CRIIRAD recommande que la CLI fasse procéder à des expertises indépendantes directement pilotées par le bureau de la CLI.